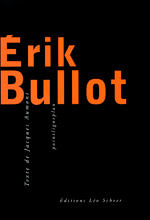Légende pour six films d’Érik Bullot
par Jean Breschand [1998]
De la Chambre noire où, dans la pénombre des jeux de l’enfance, un « théâtre d’ombres » montre un loup guettant l’oiseau dans sa cage, à Ombres chinoises où, sur une scène sans bord, quand l’ombre et la lumière s’entrelacent, un jeu de main se déploie entre le signe et le mime, les films d’Érik Bullot dessinent, sur une dizaine d’années-lumière, un territoire et une trajectoire, dont ces lignes ne sont qu’une légende, comme de celles portées au bas d’une carte avant que le voyage ne les efface.
Un territoire, pour autant qu’il appartient à chaque cinéaste de recomposer en sa nécessité cette zone d’incertitude qu’est le cinéma afin de pouvoir s’y mouvoir, d’y trouver sa place et d’expérimenter certaines de ses puissances, selon ce geste, figuré par Ovide au cœur de ses Métamorphoses, qui le restaure comme art orphique : « Il était une colline et, sur cette colline, un plateau de surface très égale, tout verdoyant d’une couche de gazon. L’ombre faisait défaut à ce lieu. Quand le poète, fils des dieux, se fut assis en cet endroit et eut fait vibrer les cordes sonores de sa lyre, l’ombre [ie les arbres dans la variété de leurs espèces] y vint1. »
Ce lieu qui fait écran, frappé d’une lumière en attente de la découpe des ombres, Érik Bullot le nomme la Chine. Il lui aura vite consacré deux films en volets, la Chine intérieure et le Jardin chinois, dont les titres font apparaître combien ce pays tient à la fois du rêve et d’une objectivation, qui pour être imaginaire n’en obéit pas moins à un principe d’ordonnancement où le hasard n’aurait sa place si ne cessait de vibrer un impondérable persistant – feuilles et frondaisons dans le vent, volutes de fumées, gonflement des voiles, envol des bulles et des baudruches… Quand la Chine intérieure s’ouvre avec deux explorateurs aventurés à la descente d’une paroi de montagne, faussement périlleuse comme dans les jeux, au pied de laquelle attend un assortiment d’accessoires indispensables à l’expédition et à ses découvertes, le Jardin chinois débute par le plan d’un paravent aux panneaux blancs dépliés, boîte énigmatique installée dans un pan de nature, tandis qu’un enfant lit un texte qui commence par ces mots : « Quant à la surface de ce jardin chinois, elle sera disposée de manière à…», inaugurant la perspective d’un aménagement paysager propice aux plaisirs d’une oisiveté affairée à ces activités essentielles et ritualisées que le film détaille en feux, jeux, promenades, processions, cérémonies d’écriture, dont la plus haute humanité se manifeste par leur raffinement affiché et emprunt d’insouciance. Cette Chine est celle des jardins de l’esprit, elle s’incarne dans les rites et la gratuité ludique d’occupations qui n’ont d’autres fins qu’elles-mêmes, se déployant dans un temps suspendu entre veille et sommeil, celui de la rêverie qui éternise le présent, détaché des liens de causalité qui finalisent les hommes ; mais c’est aussi une Chine fausse, quoique aucunement mensongère, recomposée ici dans les murs de la villa Médicis et là dans un coin des Alpes-de-Haute-Provence, qui hérite des signes d’un exotisme qu’on peut dire de pacotille, s’il s’agissait toujours de désigner une marchandise de menus objets que transportaient jadis en surplus de leur cargaison ordinaire les navires de pays lointains, celle des chinoiseries et des préciosités aux fragrances opiacées d’une fin de siècle passée, et qu’il arrive encore de trouver au gré d’une autre chine, sur les marchés qui étalent leur trésor de grenier, offrant au promeneur une forêt d’indices disposée aux plus troublantes rencontres, pour peu qu’il suive l’avertissement d’André Breton : « Il s’agit de ne pas, derrière soi, laisser s’embroussailler les chemins du désir. »
Région mythique située sur la face cachée de l’hémisphère nord, forgée dans les souvenirs de voyages, les affabulations d’écrivains pas moins embarqués que les enfants dans les gravures de lourds albums rouges, la Chine déploie ses charmes scénaristiques à demeure, dans le cadre d’une utopie offerte comme une doublure du monde, un monde parallèle, ou plutôt méridien, midi-minuit, Céleste Empire dit du Milieu, non pas un centre mais un entre-deux, où déambuler en toute quiétude, laisser le regard divaguer à sa guise sans le souci de raccorder un continuum, ce qui pour nous spectateurs, face à ce pôle de désir projeté, au lieu d’être confrontés à une intrigue, nous demande d’accueillir l’énigme d’une forme faite d’un étoilement de sensations – un rai de lumière, un souffle d’air – et de scènes – l’écriture, la peinture – éclatées en échos, pour enfin rêver le récit qui n’a cesse, à l’écart des circuits du sens, de résonner de ses tâtonnements, de réverbérer de sa mise en retrait.
Pourtant, se livrant à la marche du désir, ainsi que l’annonçait sans doute la fin du Jardin chinois, comme un reflet d’Intervista, la traversée en tramway de la Rome moderne par une gracieuse chinoise de théâtre – le plan fixe son visage contre la fuite des rues, créant une hésitation entre un réveil au monde, la révélation de sa radicale étrangeté et un dévoilement des fantômes qui le hantent –, Érik Bullot formera le projet d’un déplacement qui, remontant la ligne de l’Orient-Express, le conduira du Golfe du Lion à Istanbul, à la faveur d’une quête démystificatrice sur un personnage, à tous égards rattaché à « la série de rêves et de travaux » que déplie Borges au cours d’une de ses Enquêtes dédiée au poème rêvé par Coleridge, et dont le simple énoncé de son titre de « Directeur des phares de l’Empire ottoman », de son nom, Michel Pacha, et de son œuvre, la reconstitution de la baie du Bosphore dans la rade de Toulon, plonge en pleine fiction démiurgique cet homme qui aura rivalisé avant l’heure avec Charles F. Kane et Mabuse sur le terrain du réel, revêtant d’une doublure orientale le lieu-dit du Manteau, parmi les vestiges de laquelle nous naviguons à l’ouverture du Manteau de Michel Pacha.
Mais alors que la Chine était insituable, privées de coordonnées cardinales à l’instar de la mer où se chasse le Snark, l’ancienne Constantinople se découvre précisément orientée ; non sans être habitée de scènes chinoises (trictrac, toupies mais aussi tapis brossés, légumes pelés), Istanbul n’en révèle pas moins les tensions que produit un occident impérialiste, ce dont la fin du film témoignera en observant combien désormais « la guerre civile s’est substituée à l’exotisme. » C’est dire que le film se voit désormais conduit par le tremblé d’une trajectoire engagée à inventer sa forme ; la quête initiale se fait inquiète, le journal croise au plus près le documentaire au hasard de rencontres d’adultes et d’enfants offrant à la caméra la brûlure de leur sourire ou de leurs yeux noirs, de sorte que le voyage ne peut que ramener au point de départ comme à un lieu d’exil, laissant cependant le cinéaste fort du risque d’avoir exposé en pleine lumière son orient intérieur, conformément à la formule revendiquée d’Arthur Cravan : « il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l’ombre. »
Séchage renouvellera d’ailleurs plus sereinement cette trajectoire en accompagnant la déambulation de l’artiste catalan Perejaume par des chemins boisés, les mains portant en offrande une motte de couleurs fraîchement sorties du tube pour les baigner de la lumière des paysages traversés, consacré à un rite liturgique d’homme sans qualité dans un monde étranger (sous lequel affleurent le François d’Assise de Rossellini et le Simon du désert de Buñuel, le premier tournoie et le second se pétrifie), jusqu’au musée de peinture de Sant Pol de Mar où il dépose ce qui est devenu à notre surprise un bloc de couleurs solidifiées, provoquant ainsi un effet de trouble rétroactif quant à la durée éprouvée ; les dix minutes de pellicule condensent soudain un temps indéfiniment étiré, le film en est le cristal, il est lui-même une émulsion qui a séchée dont on peut contempler, dès lors qu’il est extrait de sa boîte, l’organisation simple des plans en facettes qui filtrent la lumière.
Cependant, cette mise à l’épreuve du songe exotique n’en n’aura pas moins produit une secousse auparavant mise en scène dans l’Ébranlement à travers un duel qui rigoureusement oppose un homme et une femme, confronte le noir et le blanc, accouple les passes de l’escrime aux panaches d’un feu d’artifice. Car le film, qui serre de près ce choc des corps, non moins ritualisé par les règles du jeu sportif, n’hésitant d’ailleurs pas à en procurer le mode d’emploi par des cartons, ne s’en tiendrait qu’à l’observation entomologiste d’un corps à corps automate s’il n’était sublimé, volatilisé par cette rencontre du faisceau moucheté et du fleuret rayonnant grâce à un art du montage, de la scansion qui transforme le battement du combat en pulsation de lumière, pour enfin toucher à un point ultime d’indifférenciation où se libère une énergie qui frappe le film d’un coup de foudre et le consume.
Nous abordons pour lors à ce qui anime la démarche d’Érik Bullot, ce mystère de la chambre noire, qu’il traque par ailleurs en arpenteur photographe : immobile ou mouvante, papier ou pellicule, l’image modèle une carte topographique, elle se déchiffre et se contemple, se parcourt et se rêve ; elle n’est pas une copie du réel mais la trace d’une région où sous couvert de s’y repérer on court se perdre. C’est pourquoi elle apparaît comme un orient, c’est-à-dire un lointain mythique, le séjour même de l’imaginaire à l’horizon duquel le soleil se lève, la lumière point, vers quoi le regard est immuablement aimanté. Chine féerique ou levant miniature, il s’agit d’évidence pour le cinéaste — ce en quoi le territoire se tient de la trajectoire décrite, que ce soit en pointillé ou par des chemins buissonniers — de révéler les images latentes qui courent sous le monde, les fantômes qui le hantent, les songes qui en sont la trame et de parvenir, ce faisant, à entrevoir ce qui inspire ces fantasmagories, le point alchimique où le monde visé par l’objectif se condense dans une émulsion, point énigmatique, aveuglant et qui est aussi bien point d’origine, où naît le regard. Or, avec ce noyau énergétique, dont toute image est en sorte l’agrandissement, nous découvrons le nœud indémêlable d’une question permanente, reconduite sous les apparences les plus diverses – depuis les jeux de cache de la Chambre noire à ces complexes de dessin et d’écriture que sont les idéogrammes en passant par les rites qui en sont la mise en scène –, et que l’on trouve explicitement formulée dans Ombres chinoises : « Vous avez vu des ombres chinoises et le langage des signes. Le mouvement des mains produit à la fois ombres et signes. Pensez-vous que ce soit la même chose ? » Cette question est celle de l’enfance de l’art, de la forme du regard, elle vibre d’une tension indécidable : les ombres sont des signes, les signes des ombres ; tension dont chaque plan est innervé, ouvrant un champ d’exploration dévolu au cinéma conformément au nom que lui donnent les Chinois d’« ombres électriques ». Tout plan se constitue de porter l’énigme de la forme, prise dans le moment de son apparition, entre perception et interprétation ; l’enfance en est la saison privilégiée, le foyer de son étonnement (le sérieux dans le jeu et le plaisir dans la connaissance en sont des manifestations) dont il est possible de retrouver le tressaillement dès lors que le plan se fait idéogramme et le récit idéographie ainsi qu’on l’aperçoit dans ce dernier film qui raconte en filigrane la venue d’une histoire sur le fond d’une zone de lumière et d’obscurité, en faisant de la découpe son événement décisif. S’il est au fond une figure qui donne au cinéma d’Érik Bullot son centre de gravité, c’est sans doute celle du trope, au sens littéral du terme, trepein, tourner. Réaliser un film est un tropisme, un mouvement d’orientation suscité par le rayonnement du monde, qui fait de l’orient le pôle d’attraction du cinéma, un point d’aimantation comme l’est le nord magnétique pour le capitaine Hatteras.
Avant de replier ces notes topographiques, j’ajouterai à la marge, là où l’arrête du papier coupe une terra incognita, que s’observent aujourd’hui ici et là les poussées d’un cinéma à venir qui remodèlent ses plateaux, réinventent sa contrée — comme Renoir composa sa Belle époque idéale —, laissent sourdre de nouvelles puissances de la fiction, au croisement du roman et de la figuration, dont ces six films font un signe de ponctuation.
Apostille pour trois films
La chance, c’est-à-dire le bonheur, pour un cinéaste, est de découvrir quelle est sa contrée. De ce jour – de ce présent –, les films alors foisonnent, ils n’en finissent plus de s’émerveiller. Le monde se ravive, reprend des couleurs, ressuscite un premier jour. C’est ce que raconte, ranime entre le conte et le rêve, les Noces chymiques. La cérémonie amoureuse qui unit les amants, sous la double protection du couple royal et des enfants de l’amour, est ancrée dans un mystère de vie et de mort – entendez, regardez : encrée dans l’esprit (celui des alcools et des gaz) de l’émulsion.
Au principe de ce rapprochement des corps, une seule et même force agit, celle de l’Attraction universelle. Les corps animaux, comme les corps célestes, sont emportés dans un même tournoiement, et leur voix se mêlent en un seul bruissement. Funambules, ils tiennent en équilibre sur un fil ; somnambules, ils suivent une ligne entrecoupée de passages au noir, de battements d’ombre qui scandent, soutiennent une musique solaire. Il y a là comme un étonnement obstiné, la répétition d’un “ et pourtant ça marche ” aussi éblouissant que l’évidence du “ sive move ”.
Le Calcul du sujet nous donne la clé de ce regard. C’est celui de l’enfance qui ouvre les yeux sur le printemps du monde. Muet, l’enfant tourne les yeux vers la lumière, vers les vibrations de couleur, vers la caméra. Sans voix, il fait ses premiers pas sur la terre, cherche son équilibre dans la course, passe dans l’ombre de l’homme à la caméra. Le monde est un jardin à sa mesure, la lumière rayonne à travers la frondaison des arbres, il palpite d’une félicité intérieure. Chaque jour est un réveil, chaque journée un tremblement. Filmer ce tremblement, cela n’a rien à voir avec le pauvre documentaire, mais avec la joie étonnée devant le mouvement du monde, le frémissement des feuilles des arbres, le déjeuner de bébé. Le merveilleux est là, à portée de main ; le film est la cérémonie qui lui rend grâce.
———————————————
1. Livre dixième, Garnier-Flammarion, Paris, 1966, p. 255.